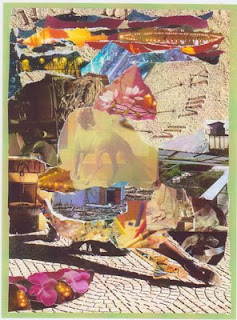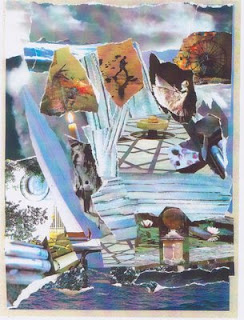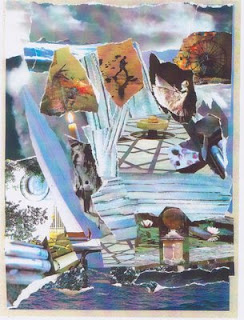
Tu te balançais d’avant en arrière dans le canapé du salon ; meurtrissant ton visage de ton poing fermé, un doigt rejoignait parfois ta bouche.
De ton corps aurait pu naître une musique que je ne percevais pas encore. Était-ce un rêve qui pour toi s’animait ou bien une douleur qui t’enveloppait si fort ?
Il m’était impossible de te saisir et plus difficile encore de saisir le sens de ton silence.
Les autres parlaient de toi comme d’un être dégénéré, inachevé mais je sentais une vivacité dans l’absence de ton regard ainsi que dans tout ce qui émanait de toi.
Ta mère me fit une liste de ce que tu n’aimais pas : manger froid et en morceau, rester dans ta chaise, entendre du piano.
Comment le savait-elle ? Tu ne te racontais pas.
Elle, détestait le piano !
Pour eux, tu restais une énigme. S’en accommodaient-ils ? Pour moi tu étais l’enfant que j’allais garder durant toute une année.
Elle me dit que tu avais deux ans. Je découvrirai plus tard que tu en avais déjà six.
Tes parents étant pris par leur travail, je te retrouvais tous les après-midis jusque tard le soir. Ton silence , je le remplissais d’histoire que j’avais inventées la veille.
Je t’installais dans la poussette conçue spécialement pour toi et nous partions découvrir les jardins alentour. Je te racontais les feuilles des arbres, les oiseaux, les lacs et les autres enfants qui devant nous jouaient, couraient et riaient tandis que tu te taisais.
Deux doigts dans la bouche, de l’autre main tu te mortifiais sans cesse. Eux nous regardaient l’un après l’autre. Dans leurs yeux apparaissaient pitié, accusation, jugement. Chacun de ces sentiments se succédaient se renouvelaient. Peut-être craignaient ils de se retrouver à notre place, ne serait-ce que pour un instant ?
A l’approche des escaliers de pierre, dans le grand jardin près de ta maison, j’avais besoin d’une aide pour te soulever à travers ses marches infranchissables. Je les cherchais alors malgré leur regard désapprobateur mais passant à nos côtés et te voyant te frapper ils devenaient sourds ou semblaient soudain désintéressés et particulièrement affairés.
Dans cette foule des après-midis printaniers il se trouvait pourtant souvent une âme qui se distinguait.
Tu te cabrais, tu t’enfuyais dans cet ailleurs inaccessible détournant brutalement la tête, pourtant nous atteignons enfin le sommet des marches.
Tu semblais effrayé par la nouveauté te tordant et hurlant toujours plus fort. Dans l’espoir de te rassurer je te racontais l’herbe coupée et les projets de notre soirée.
L’heure du repas s’accompagnait de tout un rituel. Le sol autour de ton siège était recouvert de plastique dans l’attente de tes colères.
Ces habitudes alimentaires calmaient sans doute la détresse de tes proches plus qu’elles n’allégeaient tes angoisses à l’égard de la nourriture !
Où étaient tes mots ?
Oh, tu connaissais les sons ! Les rauques, les aigus, les gazouillis. Et ton silence même, devint peu à peu pour moi un autre langage. J’apprenais à te comprendre.
Quand je te parlais, je surprenais même ton regard s’arrêtant sur ma bouche comme pour en saisir les morts. Mais, si je t’observais, tu fuyais de nouveau.
Tu acceptais que je te prenne dans mes bras et tu t’y reposais même quelques instants,
parfois.
Tu étais traité comme un nouveau-né : Langes, purée, sommeil. Si tu dérangeais en criant trop fort, le traitement de somnifère descendait de l’étagère.
Désiraient-ils vraiment te voir sortir du silence ? Peut-être ne faisais-tu que satisfaire le désir de ceux qui t’entouraient ? Je me surprenais à le penser. N’avaient-ils jamais essayé de te voir grandir ? Savais-tu, comme les autres enfants plus jeunes que toi, ce qu’était s’asseoir sur un pot et jouer à toucher et salir avec tes doigts ?
Il ne t’était offert que des choses sous plastique et tes tentatives esquissées étaient vite réprimées, même si c’était avec douceur !
Je cherchais ton désir mais n’était-ce pas en vain ?
Durant l’été ta garde me fût confiée totalement dans une maison de campagne isolée du monde, isolée des tiens. Y pensant aujourd’hui, j’étais bien jeune pour cela ayant à peine vingt ans.
Tu t’étais déjà habitué à moi et meurtrissais plus rarement ton visage.
Nos promenades à travers champs nous conduisaient à la piscine du village. Là, les enfants tentaient de jouer avec toi mais tu les craignais et te raccrochais à mes bras.
Je m’étais tricoté une veste de laine dont tu semblais apprécier la texture et la couleur. Quand tu cherchais le sommeil, je la laissais à tes côtés afin de te rassurer et t’apaiser avec mon odeur. Je réussissais ainsi à faire abstraction des somnifères et autres médicaments. Les deux premières nuits, tu m’interpellais bien. Mais ma chambre contiguë à la tienne, je me trouvais aussitôt auprès de toi et tes craintes évanouies, tu te rendormais sans angoisse jusqu’au matin.
Dans la cuisine où nous prenions nos repas je te préparais des plats à moitié mixés à moitié en petits morceaux. Nous jouions ensemble à manger les dés de jambons ou de poisson que tu dégustais sous mon regard attendri.
Tu commençais à t’exprimer autrement que par des cris.
Un jour tu poussais ton assiette hors de la table en grondant et elle s’écrasa sur le sol. Je me retournais en me fâchant mais je réalisais aussitôt ma maladresse. Ne venais-tu pas de te manifester ? L’enfant commence par dire non et tu venais d’exprimer un je ne veux pas ! Je m’excusais et te remerciais d’avoir tenté de te dire.
A ton tour tu me regardas interloqué et pour la première fois aussi droit dans les yeux. Tu avanças doucement ton bras et me caressas la joue.
Tu grandissais.
Chez toi déjà j’avais tenté de te faire marcher comme on apprend aux jeunes enfants mais l’espace de l’appartement était réduit. Dans cette maison les pièces étaient vastes et le sol du jardin assez régulier. Nous allions ensemble parler aux fleurs et raconter notre journée aux poissons dans le bassin. A la fin des vacances tu ne t’appuyais plus que sur mon petit doigt en riant. Tes mains te servaient enfin à maintenir ton équilibre quand tu élaborais un pas et non plus à te fustiger.
Comprenant que tu acceptais maintenant de dire tout en évitant soigneusement les mots, j’entrepris de t’apprendre la peinture avec les doigts, ces doigts que tu mettais souvent encore dans ta bouche. J’installai une grande feuille de papier sur la table et plaçai quelques couleurs sur une palette.
Je savais que tu m’observais, je te racontais ce que nous allions faire. Je t’y avais préparé depuis quelques jours. Je trempais moi-même l’index dans la pâte molle et dessinais quelques fleurs. Au début tu bougeais en tous sens, inquiété sans doute de salir l’espace autour de toi mais je t’expliquais qu’il s’agissait d’un jeu et te montrais comment nous pouvions réparer ensuite en enlevant la feuille pour te montrer comment la table était restée intacte. Je passais aussi mes mains sous l’eau pour te présenter mes doigts propres. Tu retrouvais peu à peu ton calme et je te suggérais d’essayer à ton tour avec mon aide.
Tu me laissas prendre ta main. Je plaçais un de tes doigts dans la peinture et te faisais découvrir la différence des teintes. Je t’expliquais ainsi comment avec le chiffon il nous serait facile de nettoyer tes doigts et de recommencer avec une autre couleur.
Je te proposais enfin d’essayer seul. Tout d’abord hésitant, tu entrepris enfin un nouveau dessin en riant.
A mesure que tu évoluais ton corps changeait. Tu t’allongeais prenant l’espace de tes bras au lieu de tenter toujours de te rétrécir comme tu le faisais auparavant.
Il me restait à t’apprendre à vivre sans l’encombrement des langes. Je t’y préparais tout d’abord en te parlant et en te montrant le pot. Je fus moi-même étonnée par ce nouveau succès. Au bout de quelques jours tu y restais assis sans qu’il fut nécessaire de rester à tes côtés.
Un matin alors que je venais de t’y installer tes parents arrivèrent par surprise.
Descendant l’escalier j’eus l’impression de t’entendre dire quelques mots. J’hésitais, prise entre le désir de revenir vers toi et mon devoir de les accueillir. Je pensais finalement avoir rêvé et m’avançais à leur rencontre.
Pourtant aujourd’hui encore je m’interroge ! Seul le ciel et les étoiles savent encore si tu ne venais pas justement de choisir cet instant pour rompre ton silence.
Te sachant seul à l’étage ta mère poussa un hurlement et monta les marches en tremblant. Je l’entendis te cajoler et te bercer de « mon pauvre petit maman est de retour ne t’inquiète pas » laissant par là entendre que j’avais dû te faire vivre d’épouvantables dangers.
Je priais en silence pour que tu cries et te débattes en formulant enfin des « Mais regarde Maman je sais marcher je suis grand je ne peux plus tomber. » Ce devait-être encore trop difficile pour toi d’affronter ce désir qu’elle manifestait de te garder ainsi en se protégeant derrière ton silence.
Je fus vite renvoyée à mes vacances pour une quinzaine de jours. A mon retour je restais quelques temps sans nouvelles. Puis un soir, je fus enfin contactée pour te garder.
Entrant chez toi, je fus envahie par une sensation étrange. Ton dîner était déjà préparé et fait comme à l’accoutumée de purée et de yaourt au cas où j’aurais pris quelques initiatives.
Ta mère me demanda d’un ton sec de changer tes langes d’ici une heure puis me devança dans la chambre où tu étais alité et attaché par des sangles.
M’approchant de ton lit je ne pouvais que retenir mes larmes découvrant la boîte de somnifère bien en vue sur l’étagère.
Ce soir là fut ma dernière soirée passée à tes côtés. Malgré le temps écoulé je pense encore à toi et à mon tour il ne me reste que le silence pour t’aimer.