
Mes Écrits, Collages ou Photos. Victoire D. Commentaires possibles en bas de page.
- victoire.dodart@gmail.com
- Sud - Ouest, France
- Des mots-Des Images en tout sens
vendredi 30 janvier 2009
mardi 13 janvier 2009
C'Etait Ailleurs !
Dans cet ailleurs lointain une femme a fixé les images de son village. Sept d’entre elles s’étalent dans le quotidien* que le hasard vient de mettre entre mes mains.
Des couleurs tendres. La lumière glisse sur les cernes et brise les ovales des visages profonds. Les regards chauds restent sévères. Accroupie comme en prière dans cet ailleurs aux mille couleurs une femme cherche la terre. J’ai cru tout d’abord au fruit d’un long métrage dont les extraits nous seraient offerts. Là, deux enfants brisent le silence de la tension de leur regard. La corde sur laquelle ils dansent vient de se rompre. Les yeux sur l’accolade du trottoir la jeune fille pétrifiée n’a plus d’âge. Au détour de son regard je suis l’ombre de son visage : L ‘asphalte pour berceau et les humeurs du caniveau comme murmures de son dernier sommeil, un enfant nouveau-né baigne seul dans la réalité des pavés.
Les fées de son chevet, bureaucrates affairés ou et ménagères au panier d’osier en bandoulière, passent devant lui d’un pas pressé sans un regard étonné.
Sous l’ombre de la ville il est resté cinq jours quand enfin une femme vient l’envelopper d’un linge. Elle lui offre comme abri une planche cloutée et un carton mouillé. Mais l’enfant froid se tait. Un vieillard à son tour l’entortille d’un souhait. Il le prend dans ses bras et sous sa maison de bois lui fait faire le voyage.
Pudique, la photographe pose son appareil en dehors de la scène. Aujourd’hui elle se cache risquant sa vie pour avoir livré au monde le quotidien de son village. Elle mérite la mort dit-on là-bas.
Mort pour avoir livré au monde l’avenir d’une enfant née fille en son pays !
Je referme le journal tentant de retrouver des images qui sont miennes mais le goût reste amer. Difficile de poursuivre sa route avec le même visage .
* Revue « Paris Match » du 17/5/01 pages 68-73. Article : Juliette Demey. Photos : Xiaolen
Des couleurs tendres. La lumière glisse sur les cernes et brise les ovales des visages profonds. Les regards chauds restent sévères. Accroupie comme en prière dans cet ailleurs aux mille couleurs une femme cherche la terre. J’ai cru tout d’abord au fruit d’un long métrage dont les extraits nous seraient offerts. Là, deux enfants brisent le silence de la tension de leur regard. La corde sur laquelle ils dansent vient de se rompre. Les yeux sur l’accolade du trottoir la jeune fille pétrifiée n’a plus d’âge. Au détour de son regard je suis l’ombre de son visage : L ‘asphalte pour berceau et les humeurs du caniveau comme murmures de son dernier sommeil, un enfant nouveau-né baigne seul dans la réalité des pavés.
Les fées de son chevet, bureaucrates affairés ou et ménagères au panier d’osier en bandoulière, passent devant lui d’un pas pressé sans un regard étonné.
Sous l’ombre de la ville il est resté cinq jours quand enfin une femme vient l’envelopper d’un linge. Elle lui offre comme abri une planche cloutée et un carton mouillé. Mais l’enfant froid se tait. Un vieillard à son tour l’entortille d’un souhait. Il le prend dans ses bras et sous sa maison de bois lui fait faire le voyage.
Pudique, la photographe pose son appareil en dehors de la scène. Aujourd’hui elle se cache risquant sa vie pour avoir livré au monde le quotidien de son village. Elle mérite la mort dit-on là-bas.
Mort pour avoir livré au monde l’avenir d’une enfant née fille en son pays !
Je referme le journal tentant de retrouver des images qui sont miennes mais le goût reste amer. Difficile de poursuivre sa route avec le même visage .
* Revue « Paris Match » du 17/5/01 pages 68-73. Article : Juliette Demey. Photos : Xiaolen
lundi 12 janvier 2009
mercredi 7 janvier 2009
L’Écho
Petit garçon au sourire de cristal
Tu m’as choisie
Comme miroir de tes peurs.
A chacune de nos rencontres,
Reflet des vacarmes indiscrets
Où tes souffrances se lisent
Dans cet espace qui est tien,
Tu pourras te poser
Ou simplement pleurer.
De tes doigts malhabiles
Tes béances assassines
Se dessinent.
Là où tu trembles,
Perdu dans cet ailleurs
Tu gommes et tu rayes.
La page blanche du carnet
Esquisse de tes secrets,
Là où tes mots découpés,
Perles à trier,
Se mêlent et se dispersent,
A grands cris
Tu te terres.
Tu déchires ton nom,
Mon oreille est patiente,
Il ne faut rien attendre.
Demain, peut-être
Tu reprendras l’écho,
Tu porteras ce nom,
Étendard de ta voix.
En moi, alors
Restera de tes pas
Le souvenir de ces traces,
Ma rencontre avec toi.
Les ailes du Piano
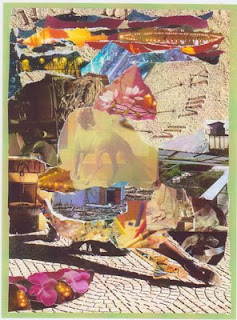
Les dalles au sol reflètent les ombres qui s’envolent telles de grandes ailes d’oiseaux migrateurs s’étendraient sur le sable humide et chaud du soleil couchant partant vers un ailleurs où secrets et quotidien s’emmêlent. Le murmure des vagues bruisse dans les cheveux de mousse qui enveloppent les anges de la fontaine. Le tintement régulier de la cloche du tramway bat dans mon dos telle la butée de l’aiguille d’un métronome imaginaire .
Soudain des rythmes naissent entre ciel et terre.
Offert au vent tiède, le corps charpenté dans sa robe dorée, il est arrivé de nulle-part. Les sons qu’il produit semble d’un autre monde, la résonance de la place rappelle le corps des cathédrales.
Les ombres sur le sol suspendent leur envol.
Une jeune femme aux pieds nus dessine des arabesques sur le pavé. Assis sur un tabouret, un jeune homme presse devant lui les touches d’ivoire parfois avec violence puis reprend avec douceur alors que le corps de la jeune fille glisse puis s‘élève vers l’absence des nuages. Elle rampe encore à effleurer les dalles.
Est-ce lui ou bien cette fille dansant à ses pieds qui dirige le bal ?
Quelques phrases encore aux rythmes plus ou moins lascifs et lui se lève pour la rejoindre. Ils disparaissent ensemble dans la première ruelle.
Un adolescent prend aussitôt place devant le corps de bois et entame des chants de terre et de brouillard, mémoire de son enfance ailleurs. Son paysage de steppes est traversé par une horde de chevaux sauvages, leur robe de la couleur des sommets himalayens, la crinière suspendue aux raies de lumière. Au cœur de son village des femmes aux cheveux tressés de rubans rouges et verts font voler leurs jupons colorés dans la crête du vent.
La solitude est douce bercée par les vents de Caucase.
D’autres rythmes s’élèvent de l’ombre d’une façade. Guidée par les saxophones et les cymbales qui se répondent, mon âme méandre lentement vers d’autres paysages faits de sel et de sable crissant sous mes pas.
Le ciel s’assombrit. Un orage se lève et le silence peu à peu s’installe. Mon regard cherche la robe dorée bordée de touches d’ivoire. La place est déserte. Seule les dalles roses luisent d’une onde plus sombre.
Je me demande si je n’ai pas rêvé.
J’ai aimé me perdre dans des ruelles plongeant vers des profondeurs sans lumière. Là où les balcons et les portes cochères, les voûtes et les places rondes émergent avec brutalité, là où même un chat ne s’aventurerait pas. Là où parlent encore les pierres dans ces cours intérieures faîtes de dentelles de fer forgé et de pavés mêlés à la terre.
De nouveau dans la lumière, j’ai cherché les traces de la robe dorée. J’ai tenté de retrouver mon chemin en direction de la fontaine de pierres et de mousse. J’ai perçu au loin les sons chauds des doigts caressant les touches d'ivoire quand les tambours frappent les cordes de métal. J’ai pressé mon pas.
Il était là. L’orage étant passé, il s’était arrêté à l’ombre des marches de l’immeuble massif que seule cette place pouvait accueillir.
Maintenant un homme d’âge mûr était assis sur le tabouret, son feutre oublié au bord de la robe de bois devenue sombre. Il dansait presque sur lui-même en battant la mesure de son pied gauche.
Je me suis assise à même les marches et suis restée encore un peu à l’écouter de peur qu’il ne prenne de nouveau son envol.
Libellés :
Nouvelles - Collages ( VD)
mardi 6 janvier 2009
La Dame de Nazaré

Le reflet de vos façades drapées de faïence bleue ou verte miroite au coucher du soleil dans la toile d’araignée que tissent les ruelles où j’ai plaisir à me perdre. Le murmure de mes pas sur les dalles inégales se mêle aux sons des ateliers imaginés derrière chacune des fenêtres entrebâillées.
Au-dessus du village veille encore l’empreinte du sabot de ce cheval qui a su arrêter sa course et protéger son cavalier. La chapelle élevée à cet effet, grande comme le berceau de vos enfants, reste la charpente de vos promenades.
Il m’est arrivée de vous rencontrer au-delà de la grève, à l’ombre de vos pierres sans âge. Le regard aussi clair que la mer que vous lisiez adossée à la falaise, votre regard portait les visages au-delà de la plage.
Je craignais de vous importuner, tant de bruit, tant de cris, viennent heurter les plis de vos multiples jupons. Je vous ai adressé une prière, partir avec une image de vous et vous m’avez souri, habituée pourtant à être volée de vos traits fatigués. Vous vous êtes redressée et dans le cadre de mon boîtier, vous êtes devenue princesse d’un autre temps : Le port de tête altier, vous avez tourné le regard chargé de votre passé au-delà des ruelles, par delà la falaise ; là où la mer un jour vous a privée de celui que vous aimiez. Je peux le lire dans vos yeux.
A l’ombre de vos épaules, une mosaïque argent et ocre faîte de poissons séchés côtoie le sable blanc et illumine chacun des traits de votre visage. Vous souriez encore pleine du désir de vous souvenir, pleine du désir de vous faire belle.
Un instant entre vous et moi, la mer s’est arrêtée de battre les rochers. Vous vous êtes reposée puis de nouveau votre regard s’est porté sur chacun des reflets des filets à vos côtés.
Libellés :
Nouvelles - Collages ( VD)
L'Eau

Les catastrophes engendrent parfois d’étranges comportements.
Cette année-là, le fleuve qui flirtait avec douceur avec le liseré du jardin de mes grand-parents décidait d’élargir son lit las de la sagesse de sa rive. Je leur rendis visite afin d’évaluer les risques encourus.
A mon arrivée, je découvris quelques hommes dans la cour en contrebas de la route. L’eau effleurait déjà la hauteur de leurs mollets protégés par des bottes de pêcheur. Ils déchargeaient avec entrain des palettes de bois le long des murs de la façade de la maison permettant ainsi d’accéder à la porte d’entrée sans risquer un bain de pieds à chaque trajet. Je sautai de planche en planche comme je le faisais aux jeux de marelle de mon enfance en espérant ne pas trébucher.
En passant le seuil, une délicieuse odeur de cuisine vînt me chatouiller les narines. Ma grand-mère attendait manifestement quelqu’un d’important pour le déjeuner.
Intriguée par ses projets je l’appelai depuis l’entrée. Elle m’apparut en haut de l’escalier dans une tenue pour le moins paradoxale étant donné les mouvements extérieurs. Elle était en effet vêtue d’un superbe tailleur bleu-ciel et chaussée d’une paire de bottes de caoutchouc. Son visage s’épanouit quand elle m’annonça l’arrivée éminente de son fils aîné. Elle ne le voyait qu’une fois par an.
J’avançai dans le salon afin de saluer mon grand-père. Tel un adolescent qui s‘apprêterait à s‘élancer au creux de la prochaine vague du haut du rochers de la falaise, il était sur la terrasse penché au bord de l’escalier de pierre qui donnait accès au jardin. Attitude fort risquée étant donné son grand âge.
Je m’approchai doucement de lui pour le découvrir un mètre à la main. L’eau, dit-il avec une éloquence que je ne lui connaissais guère, montait d’un centimètre toutes les demies-heure. Il n’en semblait pas affecté pour autant.
Ne voulant pas le brusquer, je lui demandai combien d’inondations il avait connues.
Il se redressa vivement et fit surgir avec fierté un minuscule carnet de sa poche de pantalon. Il se mit à me montrer avec attention la liste des multiples crues qu’il avait relevées depuis soixante ans. Pour chacune d’elles il avait scrupuleusement précisé la vitesse de la montée des eaux comme il le faisait à l’instant même.
Il me raconta comment une fois déjà il avait dû débarrasser le rez-de-chaussée les pieds dans l’eau s’étant laissé surprendre et avait perdu la moitié de sa bibliothèque.
Les livres étaient toutes sa vie. Il allait les choisir lui-même encore à son âge au cours de l’une de ses promenades pédestres quotidiennes. La libraire devenue une amie depuis longtemps, était enfouie dans une boutique de la taille d’une boite à chaussure. Son visage usé comme les rides laissées par la mer sur le sable quand elle se retire gardait un regard vif et chaleureux. Ils échangeaient souvent durant de longues heures.
Rangés dans son salon les livres tapissaient ensuite chacun des murs classés par auteur et par année. Il y en avait même de très anciens à la couverture sculptée d’ivoire. Chacun renfermant un secret : un article ou une page d’encre noire d’une petite écriture droite et serrée, la sienne.
Il y avait aussi les siens dont les manuscrits côtoyaient les exemplaires reliés, poésies et romans que je prenais plaisir à lire et relire et dont il m’avait offert un exemplaire dédicacé, dédicace toute particulière, à moi sa petite fille.
Malgré cela aujourd’hui encore il ne prenait aucune précaution pour se prémunir contre de nouveaux dégâts.
Sous nos yeux les branches du saule pleureur se reflétait dans l’eau qui léchait déjà son tronc avec allégresse. Les jarres prenaient un bain profond ne laissant plus apparaître que quelques pétales de fleurs. Deux canards s’approchaient des quelques marches encore à fleur d’eau. Ils semblaient vouloir se dégourdir les pattes sous nos yeux. Sidérée par l’attitude de mes grand-parents il m’était difficile de m’émerveiller face à la délicatesse du paysage qui s’offrait à moi.
Comprenant qu’ils seraient incapables de prendre une décision, je m’empressai de trouver des cartons et du journal. Fort heureusement, ma grand-mère était experte dans la collection de ce genre d’utilité. Je commençai par empiler la vaisselle de valeur sachant combien elle y était attachée même si j‘eus préféré commencer par les livres.
Les tapis et les fauteuils pourraient être montés plus tard. J’espérais l’arrivée de mon oncle pour les raisonner et m’aider à surélever les meubles.
Mon grand-père s’approcha de moi inquiet. Il me demanda pourquoi je vidais les placards quand l’eau n’avait pas encore atteint les parquets. Je lui précisai préférer faire cela les pieds au sec. Attendre encore signifiait une visite assurée de quelques rats le long de mes mollets ou pire de mes avant-bras. J’en avais aperçu quelques-uns en allant quérir les cartons dans le chai voisin.
Il ne semblait pas comprendre et continuait ses allers et retours vers la terrasse, le mètre toujours à la main.
Les informations annonçaient de plus en plus de routes coupées et prévoyaient une crue plus forte pour la nuit. A chacun de mes transport à l’étage, ma grand-mère hurlait. Il était ridicule selon elle de faire tout ce remue-ménage quand il faudrait tout redescendre. L’eau elle en était certaine n’atteindrait jamais sa maison.
Elle m’empêcha de rouler les tapis souhaitant toujours garder une pièce correcte pour l’arrivée de son fils.
Heureusement mon oncle fit enfin son apparition.
Il leur parla avec fermeté puis m’aida à déplacer les objets les plus volumineux. Nous eûmes encore le temps de relever les meubles par des parpaings.
Le soir, mes grand-parents acceptèrent tout de même de dormir à l’hôtel. L’eau ayant atteint un bon mètre à l’intérieur de leur demeure. Ils y restèrent plus d’une quinzaine de jours.
Mon grand-père venait chaque matin mesurer la hauteur de l’eau sur les façades. Il notait celle-ci dans son calepin et me téléphonait ensuite le résultat de son escapade.
Quelques semaines plus tard, il manifesta une étrange fatigue et dû suivre un traitement. Sa femme lui administrait avec empressement.
Quand ils purent intégrer de nouveau leurs murs, ils durent encore séjourner à l’étage le temps des travaux. Mon grand-père se mit à faire des chutes inexpliquées et à parler seul. Ma grand-mère préparait ses collations avec animosité lui reprochant sa déchéance. Arrivée un jour sans prévenir, je la vis le pousser pendant qu’il tentait de se vêtir.
Il devînt finalement gravement malade et dut-être hospitalisé.
Au sein du service où il était sa femme le nourrissait sans chaleur et supprimait parfois une partie de ses repas. Il n’en a pas besoin ou ne l’apprécie pas justifiait-elle.
A son chevet, elle envisageait déjà son enterrement sans amertume apparente. Elle espérait seulement ne pas devoir le veiller trop longtemps. Elle organisait sa vie sans lui et n’admettait pas de le voir revenir un jour dans sa demeure.
L’eau quitta enfin totalement le jardin. Mon grand-père, lui, ne réintégra jamais son domicile Mon oncle s’empressa de charger les objets de valeur dans le coffre de sa voiture afin d’en agrémenter son salon.
Plus tard, il n’assista pas à l’enterrement de son père.
Libellés :
Nouvelles - Collages ( VD)
Tenir

Tu t’étais attaché à Déian dès son apparition au camp. Il était maigre et portait toujours les vêtements que vous lui aviez donnés à votre arrivée. Vous en aviez distribué à tous les civils. Son pantalon écossais trop grand pour lui était retenu par une ceinture de corde.
Enfant, il représentait l’avenir de ta mission et son regard t’interrogeait sans cesse.
Il avait perdu chacun des membres de sa famille au cours du dernier hiver. Il ne lui restait que son père mais il ne le voyait guère que s’il allait errer le long des lignes de tir.
A sa manière, lui aussi participait à cette guerre. Il courait à travers la ville afin de repérer les embuscades ennemies et rapportait aux siens les informations qu’il avait pu glaner.
Tu étais là-bas pour tenter, en vain me semblait-il, d’interrompre les feux de ce combat absurde que personne ne réussissait ni à comprendre ni à arrêter.
Déian venait à ton campement pour se divertir mais aussi pour s’informer. Tu étais son espoir. Il te suivait partout de près ou de loin, selon tes activités. Il savait quand il risquait de te gêner, il le savait intuitivement.
Le dimanche était ta seule journée de repos. Il s’adossait alors à la porte de ta chambre attendant que tu t’éveilles. Quand tu commençais à bouger, il frappait.
Il te racontait son histoire et te chantait des airs qu’il avait appris quand son école tenait encore debout. Un jour, alors qu’il jouait dans la campagne alentour il avait vu son frère sauter sur une mine.
Quelques semaines plus tard, ce fût le tour de sa mère : Elle allait puiser l’eau à la seule pompe utilisable et fut atteinte par l’explosion de l’hôpital.
Puis il y eut ce matin là où tu ne l’attendais pas. Du bout du sentier, il hurlait ton nom encore maladroitement. Tu le vis courir poursuivi par un soldat de la milice.
A la grille il s’écroula.
Quand tu le pris dans tes bras il te murmura « continue » et s’endormit pour toujours.
Tu n’avais pas pu le protéger.
Continuer quoi ? Tu n’avais pas le droit d’intervenir.
Tu te mis à déambuler dans les rues, au travers des ruines à l’heure du couvre-feu te demandant encore le but de ta présence en ce lieu.
La profondeur du silence était angoissante. Tu savais que derrière chaque pilier, derrière chaque ouverture béante pouvait se cacher un traquenard.
Soudain, à deux pas, la terre se mit à craquer.
Surgissant de nulle-part un homme avançait vers toi à petit pas. Il lisait un journal ce qui te sembla insolite dans ce pays où l’information était plus lente que les bombes.
Espérait-il encore y lire un avenir ? Son avenir.
Arrivé à ta hauteur, il s’arrêta.
Méfiant tu fis un écart. Il brandit un revolver à la crosse poussiéreuse. Tu pensais vivre ta dernière heure. Que pouvais-tu faire ? L’observer, afin de mieux mesurer le temps qu’il te restait ?
Il leva le bras. Tu tremblais.
Le regard profondément vide il pressa l’arme contre sa tempe et tira.
Il s’affaissa le journal toujours dans sa main droite.
Tu fus contraint de relever son identité. Il n’était pour toi qu’un inconnu. Qui d’autre saurait ? Qui pourrait le pleurer ? Tant de monde avait fui, tant d’autres étaient déjà morts. Celui là encore était mort seul, en son pays.
Pourquoi t’avait-il choisi comme témoin de son dernier acte ?
N’étais-tu pas venu chez lui pour le libérer ?
Tu rentras au camp vomir ton impuissance.
Libellés :
Nouvelles - Collages ( VD)
lundi 5 janvier 2009
Le Silence
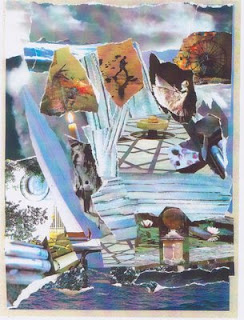
Tu te balançais d’avant en arrière dans le canapé du salon ; meurtrissant ton visage de ton poing fermé, un doigt rejoignait parfois ta bouche.
De ton corps aurait pu naître une musique que je ne percevais pas encore. Était-ce un rêve qui pour toi s’animait ou bien une douleur qui t’enveloppait si fort ?
Il m’était impossible de te saisir et plus difficile encore de saisir le sens de ton silence.
Les autres parlaient de toi comme d’un être dégénéré, inachevé mais je sentais une vivacité dans l’absence de ton regard ainsi que dans tout ce qui émanait de toi.
Ta mère me fit une liste de ce que tu n’aimais pas : manger froid et en morceau, rester dans ta chaise, entendre du piano.
Comment le savait-elle ? Tu ne te racontais pas.
Elle, détestait le piano !
Pour eux, tu restais une énigme. S’en accommodaient-ils ? Pour moi tu étais l’enfant que j’allais garder durant toute une année.
Elle me dit que tu avais deux ans. Je découvrirai plus tard que tu en avais déjà six.
Tes parents étant pris par leur travail, je te retrouvais tous les après-midis jusque tard le soir. Ton silence , je le remplissais d’histoire que j’avais inventées la veille.
Je t’installais dans la poussette conçue spécialement pour toi et nous partions découvrir les jardins alentour. Je te racontais les feuilles des arbres, les oiseaux, les lacs et les autres enfants qui devant nous jouaient, couraient et riaient tandis que tu te taisais.
Deux doigts dans la bouche, de l’autre main tu te mortifiais sans cesse. Eux nous regardaient l’un après l’autre. Dans leurs yeux apparaissaient pitié, accusation, jugement. Chacun de ces sentiments se succédaient se renouvelaient. Peut-être craignaient ils de se retrouver à notre place, ne serait-ce que pour un instant ?
A l’approche des escaliers de pierre, dans le grand jardin près de ta maison, j’avais besoin d’une aide pour te soulever à travers ses marches infranchissables. Je les cherchais alors malgré leur regard désapprobateur mais passant à nos côtés et te voyant te frapper ils devenaient sourds ou semblaient soudain désintéressés et particulièrement affairés.
Dans cette foule des après-midis printaniers il se trouvait pourtant souvent une âme qui se distinguait.
Tu te cabrais, tu t’enfuyais dans cet ailleurs inaccessible détournant brutalement la tête, pourtant nous atteignons enfin le sommet des marches.
Tu semblais effrayé par la nouveauté te tordant et hurlant toujours plus fort. Dans l’espoir de te rassurer je te racontais l’herbe coupée et les projets de notre soirée.
L’heure du repas s’accompagnait de tout un rituel. Le sol autour de ton siège était recouvert de plastique dans l’attente de tes colères.
Ces habitudes alimentaires calmaient sans doute la détresse de tes proches plus qu’elles n’allégeaient tes angoisses à l’égard de la nourriture !
Où étaient tes mots ?
Oh, tu connaissais les sons ! Les rauques, les aigus, les gazouillis. Et ton silence même, devint peu à peu pour moi un autre langage. J’apprenais à te comprendre.
Quand je te parlais, je surprenais même ton regard s’arrêtant sur ma bouche comme pour en saisir les morts. Mais, si je t’observais, tu fuyais de nouveau.
Tu acceptais que je te prenne dans mes bras et tu t’y reposais même quelques instants,
parfois.
Tu étais traité comme un nouveau-né : Langes, purée, sommeil. Si tu dérangeais en criant trop fort, le traitement de somnifère descendait de l’étagère.
Désiraient-ils vraiment te voir sortir du silence ? Peut-être ne faisais-tu que satisfaire le désir de ceux qui t’entouraient ? Je me surprenais à le penser. N’avaient-ils jamais essayé de te voir grandir ? Savais-tu, comme les autres enfants plus jeunes que toi, ce qu’était s’asseoir sur un pot et jouer à toucher et salir avec tes doigts ?
Il ne t’était offert que des choses sous plastique et tes tentatives esquissées étaient vite réprimées, même si c’était avec douceur !
Je cherchais ton désir mais n’était-ce pas en vain ?
Durant l’été ta garde me fût confiée totalement dans une maison de campagne isolée du monde, isolée des tiens. Y pensant aujourd’hui, j’étais bien jeune pour cela ayant à peine vingt ans.
Tu t’étais déjà habitué à moi et meurtrissais plus rarement ton visage.
Nos promenades à travers champs nous conduisaient à la piscine du village. Là, les enfants tentaient de jouer avec toi mais tu les craignais et te raccrochais à mes bras.
Je m’étais tricoté une veste de laine dont tu semblais apprécier la texture et la couleur. Quand tu cherchais le sommeil, je la laissais à tes côtés afin de te rassurer et t’apaiser avec mon odeur. Je réussissais ainsi à faire abstraction des somnifères et autres médicaments. Les deux premières nuits, tu m’interpellais bien. Mais ma chambre contiguë à la tienne, je me trouvais aussitôt auprès de toi et tes craintes évanouies, tu te rendormais sans angoisse jusqu’au matin.
Dans la cuisine où nous prenions nos repas je te préparais des plats à moitié mixés à moitié en petits morceaux. Nous jouions ensemble à manger les dés de jambons ou de poisson que tu dégustais sous mon regard attendri.
Tu commençais à t’exprimer autrement que par des cris.
Un jour tu poussais ton assiette hors de la table en grondant et elle s’écrasa sur le sol. Je me retournais en me fâchant mais je réalisais aussitôt ma maladresse. Ne venais-tu pas de te manifester ? L’enfant commence par dire non et tu venais d’exprimer un je ne veux pas ! Je m’excusais et te remerciais d’avoir tenté de te dire.
A ton tour tu me regardas interloqué et pour la première fois aussi droit dans les yeux. Tu avanças doucement ton bras et me caressas la joue.
Tu grandissais.
Chez toi déjà j’avais tenté de te faire marcher comme on apprend aux jeunes enfants mais l’espace de l’appartement était réduit. Dans cette maison les pièces étaient vastes et le sol du jardin assez régulier. Nous allions ensemble parler aux fleurs et raconter notre journée aux poissons dans le bassin. A la fin des vacances tu ne t’appuyais plus que sur mon petit doigt en riant. Tes mains te servaient enfin à maintenir ton équilibre quand tu élaborais un pas et non plus à te fustiger.
Comprenant que tu acceptais maintenant de dire tout en évitant soigneusement les mots, j’entrepris de t’apprendre la peinture avec les doigts, ces doigts que tu mettais souvent encore dans ta bouche. J’installai une grande feuille de papier sur la table et plaçai quelques couleurs sur une palette.
Je savais que tu m’observais, je te racontais ce que nous allions faire. Je t’y avais préparé depuis quelques jours. Je trempais moi-même l’index dans la pâte molle et dessinais quelques fleurs. Au début tu bougeais en tous sens, inquiété sans doute de salir l’espace autour de toi mais je t’expliquais qu’il s’agissait d’un jeu et te montrais comment nous pouvions réparer ensuite en enlevant la feuille pour te montrer comment la table était restée intacte. Je passais aussi mes mains sous l’eau pour te présenter mes doigts propres. Tu retrouvais peu à peu ton calme et je te suggérais d’essayer à ton tour avec mon aide.
Tu me laissas prendre ta main. Je plaçais un de tes doigts dans la peinture et te faisais découvrir la différence des teintes. Je t’expliquais ainsi comment avec le chiffon il nous serait facile de nettoyer tes doigts et de recommencer avec une autre couleur.
Je te proposais enfin d’essayer seul. Tout d’abord hésitant, tu entrepris enfin un nouveau dessin en riant.
A mesure que tu évoluais ton corps changeait. Tu t’allongeais prenant l’espace de tes bras au lieu de tenter toujours de te rétrécir comme tu le faisais auparavant.
Il me restait à t’apprendre à vivre sans l’encombrement des langes. Je t’y préparais tout d’abord en te parlant et en te montrant le pot. Je fus moi-même étonnée par ce nouveau succès. Au bout de quelques jours tu y restais assis sans qu’il fut nécessaire de rester à tes côtés.
Un matin alors que je venais de t’y installer tes parents arrivèrent par surprise.
Descendant l’escalier j’eus l’impression de t’entendre dire quelques mots. J’hésitais, prise entre le désir de revenir vers toi et mon devoir de les accueillir. Je pensais finalement avoir rêvé et m’avançais à leur rencontre.
Pourtant aujourd’hui encore je m’interroge ! Seul le ciel et les étoiles savent encore si tu ne venais pas justement de choisir cet instant pour rompre ton silence.
Te sachant seul à l’étage ta mère poussa un hurlement et monta les marches en tremblant. Je l’entendis te cajoler et te bercer de « mon pauvre petit maman est de retour ne t’inquiète pas » laissant par là entendre que j’avais dû te faire vivre d’épouvantables dangers.
Je priais en silence pour que tu cries et te débattes en formulant enfin des « Mais regarde Maman je sais marcher je suis grand je ne peux plus tomber. » Ce devait-être encore trop difficile pour toi d’affronter ce désir qu’elle manifestait de te garder ainsi en se protégeant derrière ton silence.
Je fus vite renvoyée à mes vacances pour une quinzaine de jours. A mon retour je restais quelques temps sans nouvelles. Puis un soir, je fus enfin contactée pour te garder.
Entrant chez toi, je fus envahie par une sensation étrange. Ton dîner était déjà préparé et fait comme à l’accoutumée de purée et de yaourt au cas où j’aurais pris quelques initiatives.
Ta mère me demanda d’un ton sec de changer tes langes d’ici une heure puis me devança dans la chambre où tu étais alité et attaché par des sangles.
M’approchant de ton lit je ne pouvais que retenir mes larmes découvrant la boîte de somnifère bien en vue sur l’étagère.
Ce soir là fut ma dernière soirée passée à tes côtés. Malgré le temps écoulé je pense encore à toi et à mon tour il ne me reste que le silence pour t’aimer.
Libellés :
Nouvelles - Collages ( VD)
dimanche 4 janvier 2009
Barbelés en rivière

Elles viennent de lâcher le fil de barbelé accroché à leurs dents durant douze saisons.
Chacun de ces instants s’accompagne d’un nouveau livre de larmes. Chacune de ces rencontres avec l’homme en blouse blanche et son lot de pinces coupantes était suivie de douleurs qui rendaient chaque bouchée, même la plus désirée : chocolat chips ou autre volupté, le pire enfer que la terre ait pu leur offrir et rendait anorexique pour deux ou trois repas la plus gourmande des quatre.
Elles ont pourtant troqué leur bouche grillagée pour quelques vis et trous plus ou moins espacés sur leur lèvre du haut, du bas, ou les deux à la fois afin de tisser le silence des mots du cœur, un ou deux sur la langue pour éloigner les baisers sans omettre le nez afin de rejeter toute la saveur des embruns au bord de l’océan et du miel doré à l‘aube du Printemps.
La vie les aurait-elle rendues à ce point amères que le short fleuri et le t-short au bord des seins ne soient plus qu’une arme pour mieux happer l’autre dans les griffes du cœur oublié telle l’araignée du matin tissant sa toile au bord de la rosée afin de mieux trahir l’insecte. Ont-elles déjà troqué leurs rêves les plus secrets pour cette bouche amère ? Pourtant leurs pommettes se transforment en crevettes au couchant ou crabe sur les braises quand le jeune homme assis face à elle leur offre son sourire timide au dessus du verre menthe à l‘eau.
Mais ce feu qui les brûle est-il si dangereux qu’elles doivent dresser de nouveaux grillages et portes blindées.
Que leur dire des autres, censés guider leurs pas vers l’autre rive, celle de la liberté ?
Je déteste ce temps des départs, cet âge où le monde se doit d’être raisonnable.
Je déteste encore ce regard en biais sur la courbe de mon mollet montant jusqu’à mon ventre sans interrogation sur mon cœur en dedans.
Je déteste quand tu pars et que les vents t’éloignent mais je déteste autant quand mon ventre se tord et que mon vocabulaire se réduit à quelques mots aussi vides que la bourse d’un mendiant ... Je déteste quand je ne sais plus gérer le temps qui nous sépare. Je déteste quand j’oublie la douceur de ta bouche, happée par le vide de ton temps de vacances.
Je préfère retrouver le silence et me blottir dans le souvenir de tes murmures.
Je déteste leur rire quand ils ont bu et ces enfants qui pleurent et que l’on bat quand ils rêvent de tendresse et de bras pour mieux les enlacer.
Je déteste la pluie fine et le froid de l’hiver et le cri des parents qui ne veulent pas entendre les rêves de leur adolescent.
Je déteste la cravache qui tombe sur le dos du cheval et le pouvoir des hommes qui mesurent leur bras et étalent leur savoir auquel ils ne croient pas.
Je déteste ces matins de Noël quand les frontières sont la cible des bombes jetées au nom du divin quand ailleurs encore les grands hommes s’échappent au bord d’océans lointains sanctifiant des compatriotes qui se sont nourri de ceux qui dorment aujourd’hui sous des tentes de misère.
Je déteste quand les enfants ont peur du noir et que les savants se moquent des histoires.
Inscription à :
Articles (Atom)








