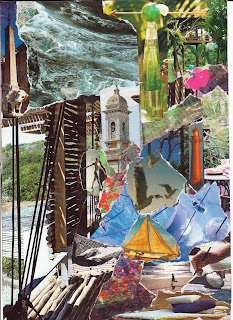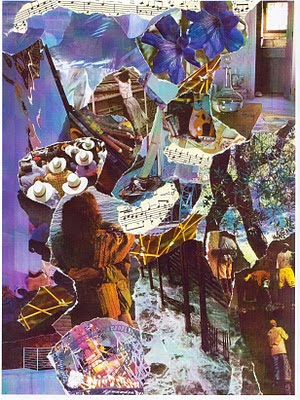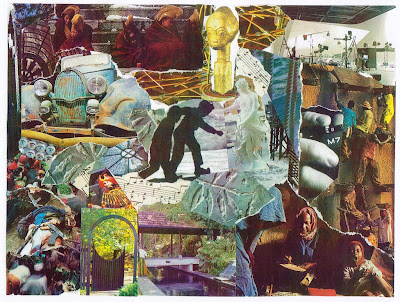Noémie bouge lentement à l’étage. Les paupières encore alourdies, elle entrouvre les persiennes. C’est l’aube au-dehors. La brume enveloppe des collines desséchées comme pour les protéger d’un regard trop pressé. Elle se décide enfin, bascule sur les marches de l’escalier qu’elle dévale avec lourdeur pour arpenter le rez-de-chaussée avec lenteur. J’aime son pas à la nonchalance un peu lourde qui n’appartient qu’à elle. Elle me murmure un bonjour inarticulé en poussant la porte d’entrée.
- " Noémie tu es nu-pieds. "
- " Et alors ! " me répond-t-elle agacée.
- " Noémie tu es nu-pieds. "
- " Et alors ! " me répond-t-elle agacée.
Indifférente, je l’aurais sans doute inquiétée. Je la sens sourire. La pièce où je vis est sombre. Les murs sont épais et le plafond bas. J’ai froid. Noémie est vulnérable. Je me demande avec effroi ce qu’elle va devenir. Chaque minute du jour ou de la nuit est pour elle un éternel combat qui la fait frémir et altère son magnifique visage. Toujours elle bouge, tourne, se cogne, tandis que les mots, en elle, se taisent. Je me demande toujours d’où peut provenir cette peur qui l’habite et quand sera-t-elle apaisée.
* * *
Je me souviendrai jusqu’à ma dernière heure de l’instant où elle se heurta pour la première fois à mon espace. Mes yeux se nourrissent de la nuit. Les bras légèrement portés en avant je me suis avancée vers elle avec maladresse et j’ai senti son petit corps frissonner malgré ses trois ans. Sa tête s’est balancée afin de fuir ce qui restait de mon regard. Elle s’est échappée sur le sentier et la religieuse qui l’accompagnait l’a rudoyée.
Le soir, seule avec moi, elle s’est blottie contre la porte d’entrée. Mon fils Gabriel s’était protégé à l’étage. Assise sur la marche de pierre, son corps répond à chacun des bruits insolites que je ne perçois qu’à travers elle. Je lui ai parlé longuement, réinventant pour elle ma vie ici. Mais elle s’était murée dans le silence.
Je l’aimais déjà !
Je lui décrivis le jardin potager et les tâches que je devais y accomplir chaque jour. Sans espoir je lui proposai de m’y accompagner. M’engageant avec maladresse sur la terre humide, je sentis sa présence fragile dans mon dos.
Est-ce parce que ma voix lui avait soudain paru plus douce ? Est-ce parce que je lui avais demandé son aide pour cueillir les fruits mûrs que je ne pouvais discerner ? Elle ne me le dirait jamais mais elle resta à mes côtés.
Elle cessa de trembler et accueillit, non sans un sursaut, la paume de ma main sur sa chevelure d’ébène. Elle sentait la lavande et j’en aimais le parfum. Je le lui dis. Elle se rapprocha de moi, se pencha un peu et m’offrit sa nuque en me l’indiquant de ses doigts d’enfant.
Je ne sais pourquoi elle venait de me choisir et m’avait apprivoisée.
Auprès de moi, longtemps elle garda le silence. Je pleurais parfois reconnaissant la douleur de ce petit corps à l’histoire morcelée. Ce temps-là me sembla une éternité !
Une nuit, les larmes habitant mon sommeil, je perçus son pas hésitant sur le parquet de ma chambre. Elle n’en avait jamais encore franchi le seuil. J’attendis espérant un instant indéfinissable.
Elle approcha sa petite main tremblante de mon visage murmurant un « pardon » à mon oreille. Surprise par le son de sa voix, dans ma nuit, j’entrouvris les paupières. Je la pris dans mes bras et la berçais avec tendresse.
- « Je ne voulais pas vous faire de mal. » murmura-t-elle avant de s’endormir tout contre moi tel un louveteau sur le ventre de sa mère.
* * *
Au-dehors, Noémie retournait la terre sèche à l’aide d’une fourche au manche usagé. Son front se plissait et son dos ruisselant ployait afin de vaincre l’effort. Le fils de Mamouchka était parti depuis de longs mois et elle se languissait en silence.
Cette vieille femme l’exaspérait en la conseillant depuis son fauteuil chaque matin le visage impassible.
-« Ne fais pas des rangs trop serrés ! » disait-elle toujours.
-« Quels rangs ? Qu’est-ce-que ça peut faire ? » lui répondait-elle avec violence.
-« Ne parle pas ainsi. Tu me fais mal. »
-« Et alors ! » reprenait la jeune fille pour elle-même, détestant ce ton de victime que l’autre prenait espérant la rendre coupable.
- « Noémie. Viens près de moi ! »
Elle allait encore la flatter de sa morale. Noémie sauvage et silencieuse se dirigeait vers l’extérieur.
-« C’est facile d’être toujours douce et mielleuse ! » venait-elle d’ajouter avant de claquer la porte derrière elle.
* * *
Des yeux morts de Mamouchka naissaient des larmes amères. Que s’était-il passé pour que cette enfant semble tellement la haïr ?
Une voiture venait de s’arrêter au bout du sentier. Reconnaissant le facteur, Noémie s’avança à sa rencontre. Elle arracha la lettre des mains du vieil homme. Hésitant un instant, elle découvrit un timbre étranger et l’écriture serrée de Gabriel. Son corps se mit à frémir.
Elle aurait aimé l’ouvrir mais elle était adressée à Mamouchka.
De toute façon elle ne pourra pas la lire ! se dit-elle. Le regard provoquant à l’adresse de Mamouchka, elle déchira le papier flétri par le transport. Un instant satisfaite de transgresser les règles établi par la vieille dame elle n’était déjà plus intéressée.
-« Noémie qu’est-ce-que c’est ? »
-« Une lettre de Gabriel. Votre très cher Gabriel ! » reprit-elle lui jetant l’enveloppe sur les genoux avant de grimper l’escalier.
Le regard de la femme se ferma derrière ses paupières.
A l’étage, Noémie martelait le sol et tournait dans sa chambre ouvrant et referma les tiroirs de sa commode.
Mamouchka l’écoutait. Ses doigts tremblant parcourraient le papier le humant essayant en vain de saisir le sens des mots.
Blessée de cette dépendance elle froissa les feuillets entre ses paumes et les pressa dans les plis de sa robe.
Noémie descendit enfin et la dévisagea en silence. Une douleur inexprimée imprégnait son visage.
-« Je vais partir ! » dit-elle.
La femme leva la tête dans sa direction.
S’engageant sur le chemin Noémie malgré elle perçut les derniers mots de Mamouchka :
-« Je ne comprends pas. Ma porte te serra toujours ouverte. Quand croiras-tu que dans cette maison tu es profondément aimée ?
* * *
Au bout du sentier voyant un homme s’avancer vers elle la jeune fille hésita. Seul le facteur prenait ce chemin.
Dans sa mémoire jaillit alors le souvenir de ses jeux d’enfant avec Gabriel. Le jeune homme avait une barbe naissante mais elle n’avait jamais oublié ce regard.
A ma fille